À Taïwan, il est courant d’embaucher des femmes du Sud-Est asiatique pour partager la vie d’une personne âgée en perte d’autonomie. Mais l’exploitation guette ces travailleuses essentielles, qui n’ont même pas droit au salaire minimum.
Des femmes comme Fajar, on en voit dans toutes les rues de Taïwan. Souvent coiffées d’un voile islamique qui indique leur origine étrangère, elles poussent un fauteuil roulant jusqu’au parc le plus proche, où elles peuvent enfin s’asseoir et pianoter sur leur téléphone. Un boulot moins facile qu’il ne semble.
« Pendant mes trois premières années ici, je n’ai pas eu le moindre jour de congé, se souvient cette Indonésienne de 45 ans. Je travaillais pour tout le monde dans la maison, alors que j’étais censée prendre soin des parents seulement. J’ai même cuisiné pour 26 personnes lors d’une fête! Quand j’ai pu changer de famille, j’ai enfin eu droit à un congé : un dimanche par mois, de 8 h à 18 h. »
Agences en réseau

Fajar
Depuis les années 1990, Taïwan fait appel à 200 000 travailleuses migrantes d’Asie du Sud-Est, en grande majorité des Indonésiennes et des Philippines, pour s’occuper de ses aîné(e)s en perte d’autonomie. Car sur l’île asiatique, les résidences pour personnes âgées sont rares : la culture chinoise veut que les enfants prennent soin de leurs parents vieillissants. Une tâche qui devient trop lourde pour eux, dans une société aux prises avec un vieillissement accéléré et une chute de la natalité.
Il suffit d’obtenir un certificat médical pour faire venir une migrante, qui partagera pendant trois ans le logement d’une personne âgée et veillera sur elle en permanence. Pour trouver la perle rare, les familles font affaire avec un réseau transnational d’agences de recrutement « qui nous exploitent », selon Fajar.
« La première fois que je suis venue, j’ai dû payer 99 000 pesos (2 400 $ CA) à l’agence aux Philippines », se souvient Clarita qui s’est ensuite occupée d’« une dame dont les enfants très riches étaient toujours partis aux États-Unis ». Pour payer ces « frais de placement » obligatoires, les travailleuses sont contraintes d’emprunter de l’argent avec un taux d’intérêt élevé avant leur départ.
Une fois au travail, elles paient aussi des « frais de service » à leur broker (le nom couramment donné à l’agence taïwanaise) – 1 800 dollars taïwanais (77 $ CA) par mois la première année, par exemple. En échange, l’agence les aide en cas d’ennui de santé ou pour renouveler leurs documents. Cela est contraire à la pratique internationale, qui veut que ce soit l’employeur (dans ce cas, la famille) qui paie ces frais.
Violences et injustices au quotidien
Pourtant, les services fournis ne sont pas toujours à la hauteur. « On m’a diagnostiqué un cancer du sein en 2022 et mon traitement me donnait la nausée et des vertiges, raconte Clarita. J’ai contacté mon broker, mais il m’a dit de continuer à travailler jusqu’à la fin de mon traitement. Il n’avait pas intérêt à ce que j’arrête : chaque mois, je lui versais de l’argent! »
Clarita a alors appelé la ligne d’aide mise en place par le gouvernement. À la suite d’une médiation, elle a pu aller dans le refuge d’une association d’aide aux travailleurs migrants, Serve the People, le temps de se soigner. Elle a aujourd’hui retrouvé ses cheveux noirs et s’apprêtait à reprendre le travail dans une nouvelle famille lorsque nous l’avons rencontrée.
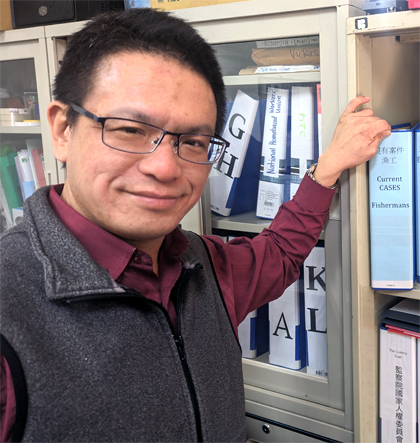
Lennon Wong, directeur du refuge Serve the People
Directeur de ce refuge situé dans un lieu gardé secret en banlieue de Taipei, Lennon Wong peut parler longtemps des abus qu’il a constatés au fil des ans, de la part des agences et des familles… voire des personnes aînées elles-mêmes. « Ils semblent inoffensifs, mais l’expérience nous apprend que quand ils perdent la tête, ils peuvent attaquer en mordant, en griffant ou en frappant alors que vous les habillez. Il y a des agressions sexuelles, car les aidantes dorment souvent dans la chambre du patient, parfois dans le même lit… quand ça ne vient pas d’un autre homme de la maison. »
Cerise sur le sundae, ces travailleuses n’ont même pas droit au salaire minimum (1 173 $ par mois), car « leurs heures de travail sont difficiles à délimiter », justifie Hu Hsing-Yeh, une cadre du ministère du Travail responsable de la main-d’œuvre étrangère. Elles ne touchent que 854 $ par mois, et leur contrat n’indique aucune limite d’heures travaillées. Tout juste stipule-t-il qu’elles doivent avoir un jour de congé par semaine.
« En théorie, elles ne doivent faire que des tâches reliées au patient, rappelle Lennon Wong. Mais on va souvent leur demander de nettoyer la maison de fond en comble, ou de travailler dans le restaurant familial. » Beaucoup acceptent de sacrifier leur journée de congé contre un paiement au noir, afin d’envoyer un peu plus d’argent à leurs enfants restés au pays. « Elles se plaignent seulement quand elles ne peuvent plus endurer leur situation », regrette Lennon Wong.
« Avec des gens atteints de démence, il arrive qu’on travaille plusieurs jours et nuits sans dormir », abonde Fajar qui a créé Ganas, une association qui milite pour les conditions de travail des travailleur(-euse)s migrant(e)s indonésien(ne)s. « En particulier, on aimerait pouvoir changer d’employeur plus facilement », poursuit-elle. Pour l’instant, une telle mutation n’est permise qu’en cas d’accord mutuel avec l’employeur ou de gain de cause à la suite d’une plainte, laissant nombre d’entre elles dans des milieux hostiles pour trois ans.
De timides avancées
Le sort des aidantes s’améliore doucement, assure-t-on quand même au ministère du Travail où Hu Hsing-Yeh énumère des avancées récentes : hausse de salaire, couverture en cas d’accident du travail, mais aussi stage obligatoire tant pour les familles que pour les travailleuses pour que les droits de ces dernières soient bien connus de tous.
Cependant, une revendication majeure des travailleur(-euse)s migrant(e)s reste lointaine : la suppression des agences de recrutement. Difficile, en effet, de se passer de leurs contacts à l’étranger et de leur aide pour surmonter la barrière de la langue. Les agences peuvent toutefois faire partie de la solution, comme le montre le cas de May-God : ce broker basé à Taichung est le seul de l’île qui facture ses frais de service aux employeurs plutôt qu’aux travailleuses. Cela coûte plus cher, mais l’agence fournit des femmes expérimentées, formées et capables de parler chinois.
Taïwan sera de toute façon obligé de s’améliorer ainsi pour continuer à prendre soin de ses personnes aînées, pense Huang Hsiang-Jung, l’assistante du président de May-God. « De moins en moins d’aidantes veulent venir aujourd’hui, car la demande explose aussi au Japon et en Corée du Sud, et le salaire est meilleur là-bas. Et ces femmes ont de plus en plus conscience de leurs droits, alors il devient difficile de leur mentir, comme beaucoup d’agences le font. »
De son côté, Lennon Wong pense que le nerf de la guerre est le manque de ressources financières affectées aux soins de longue durée (qui dépendent d’une taxe sur le tabac). Tant que cela ne changera pas, le coût politique pour améliorer considérablement les conditions de travail des aidantes sera trop grand, puisque le fardeau financier retombera sur les familles qui les emploient. « Beaucoup d’employeurs seraient fâchés, lance-t-il. Car ce système leur permet d’abuser des travailleuses, et ils s’y sont un peu trop habitués… »










