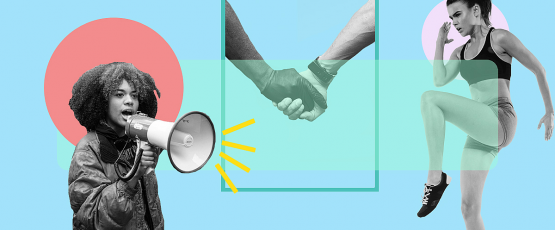Lors des derniers Jeux d’été à Rio, en 2016, 73 % des médailles canadiennes ont été gagnées par des athlètes féminines. On pourrait croire que les femmes ont maintenant leur place dans les sports d’élite. Mais dans les coulisses, le portrait est moins reluisant.
Si les Jeux de Tokyo affichent cet été une parité parmi les athlètes et les disciplines, certaines épreuves seront encore exclusivement masculines. C’est à Paris, en 2024, que nous verrons réellement des Olympiques paritaires, autant chez les athlètes que dans les disciplines et les épreuves. Un long chemin de 128 ans depuis les premiers Jeux pour y arriver.
Plusieurs préjugés demeurent et les athlètes, de tous les genres, hésitent encore à se faire entraîner par des femmes. Il y a même eu un ressac ces dernières années. On retrouve aujourd’hui environ 18 % d’entraîneures, alors qu’elles étaient 25 % il y a une dizaine d’années.
« L’arrivée massive de femmes dans le sport dans un court laps de temps a été dérangeante pour les structures », explique Guylaine Demers, professeure au Département d’éducation physique à l’Université Laval et codirectrice du Centre de recherche canadien sur l’équité des genres en sport. On a fait de la place aux athlètes féminines, mais on n’a pas augmenté le nombre de structures pour autant. Par exemple, ni le nombre de fédérations ni celui des médias sportifs n’ont nécessairement doublé.
Un environnement dissuasif

Guylaine Demers, professeure au Département d’éducation physique à l’Université Laval
« C’est venu brasser la prédominance du sport masculin, poursuit Guylaine Demers. La résistance est apparue dans les postes de leadership. Pas nécessairement de manière réfléchie. On a fait de la place sur les terrains, mais les hommes ont gardé le contrôle des sports. Le système n’est pas devenu plus accueillant, au contraire. »
Une femme reste environ 3,8 ans comme entraîneure, alors qu’un homme va exercer ce métier environ 11 ans. « Et ce n’est pas dû à la maternité, contrairement à ce que certains disent », insiste Guylaine Demers. Ces femmes pourraient reprendre leur rôle après leur congé de maternité comme dans un autre milieu – et si ce n’était pas le cas, ça serait ironiquement un bon exemple de sexisme.
La professeure explique que l’ambiance est dissuasive pour les femmes : « Il y a encore beaucoup de discrimination, de harcèlement, d’iniquités salariales. Les idées des femmes sont invalidées, on leur coupe la parole. » Les femmes se fatiguent, se tannent et quittent le sport d’élite.
Moins de 1 % des entraîneures accompagnent des athlètes masculins. « Avant, on disait que les femmes n’avaient pas d’expérience du sport pour entraîner, même si on ne demande pas aux hommes d’avoir été des athlètes. Maintenant que les femmes ont l’expérience, on dit qu’elles n’ont pas celle du sport masculin. Mais on ne demande jamais aux hommes d’avoir l’expérience du sport féminin pour entraîner des femmes. » Plus on monte dans la pyramide du sport d’élite, moins il y a de femmes.
Guylaine Demers croit qu’il faut sensibiliser les athlètes dès leur jeune âge. Dans un monde idéal, sans contraintes budgétaires ou de personnel, toutes les équipes sportives dans les écoles devraient avoir un entraîneur et une entraîneure. « C’est impossible, mais les équipes de filles devraient être entraînées par des femmes. Ça habituerait les jeunes à voir des femmes dans des rôles de leaders. » Il y aurait aussi un effet d’entraînement. « Il faut donner envie aux athlètes, après leur carrière, de devenir entraîneure ou présidente de leur fédération. Pour ça, leur propre expérience doit avoir été agréable. Si on ne voit pas que ça existe, on pense que c’est impossible », ajoute la chercheure.
Donner l’exemple
« Là où le bât blesse, croit Guylaine Demers, c’est dans la manière dont les médias traitent les sports féminins. Ce ne sont pas les sports les mieux diffusés. »
La journaliste et animatrice de Radio-Canada Marie-José Turcotte souligne que ça change. Il serait impensable, aujourd’hui, de ne pas diffuser les finales de natation, hommes et femmes, à heures de grande écoute aux États-Unis. « Mais oui, on a longtemps favorisé les hommes, et il y a encore beaucoup de défis pour le sport professionnel », ajoute-t-elle.
Les chiffres ne mentent pas. Selon l’UNESCO, à peine 4 % du contenu médiatique mondial a été consacré au sport féminin en 2018 et seulement 12 % des nouvelles sportives concernaient les athlètes féminines. Parmi les 100 athlètes les mieux rémunéré·e·s de la planète, on ne retrouve que 2 femmes.
Les écoles offrent plus de programmes pour les garçons que pour les filles. Les équipes féminines sont généralement les premières coupées lorsqu’il y a des compressions. Guylaine Demers déplore que plusieurs parents ne se battent pas pour que leurs filles puissent pratiquer le sport qu’elles souhaitent, comme si ce n’était pas grave. C’est souvent l’absence d’organisations qui rompt le parcours d’une jeune sportive.
On a fait de la place aux athlètes féminines, mais on n’a pas bonifié les structures pour autant.
Plus on va diffuser du sport féminin, plus il y aura une demande et plus il y aura des infrastructures pour les athlètes féminines, du sport récréatif dans la petite enfance jusqu’au sport d’élite. Il faut des politiques inclusives adoptées par les hautes directions (top down), mais il faut aussi que ça vienne de la base. Que ce soit enraciné, du bas vers le haut (bottom up).
Catherine Dupont, première directrice, sports et production olympique à Radio-Canada, est consciente de la situation et veut faire partie de la solution. Par exemple, la chaîne nationale a récemment commencé à webdiffuser la NWSL, le plus haut niveau de soccer féminin des États-Unis.
Le diffuseur souhaite aussi augmenter le nombre d’analystes féminines en ondes. « De Rio à Tokyo, on est passé de 15 % à 30 %. Notre objectif est d’atteindre 50 % », explique Catherine Dupont.
Radio-Canada a d’ailleurs mis sur pied le programme Tremplin pour former des athlètes à la retraite afin qu’elles deviennent analystes ou commentatrices. Plus on entendra des femmes partager leur expertise, moins on remettra en question leur place dans des postes clés.
Vers un changement de cap
La façon d’analyser et de présenter le sport n’est pas anodine. Pendant longtemps, on a considéré certaines caractéristiques sportives comme exclusivement masculines. Quand des femmes démontrent de la force, de l’agressivité, un esprit de compétition, on remet en question leur féminité. À l’inverse, lorsqu’une entraîneure propose une approche moins agressive, on met en doute sa crédibilité, malgré ses résultats.
« Il existe encore une peur chez les femmes de développer trop de muscles pour leur image, raconte Guylaine Demers. Il y a un souci de garder une apparence féminine. » Heureusement, on voit de plus en plus de femmes être fières de leurs corps athlétiques.
La chercheure se montre optimiste : « Avant, les réactions dans les fédérations n’étaient pas amicales. Les générations changent, les hommes sont plus ouverts et reconnaissent l’enrichissement et la complémentarité des femmes. Depuis trois ans, on constate un changement. J’ai hâte de voir les chiffres dans cinq ans. »
Les classes de la professeure sont composées à 38 % de femmes. Elles pourraient bien changer le portrait. D’autant plus que même le sport professionnel s’ouvre tranquillement. Voir une Becky Hammon devenir entraîneuse des Spurs de San Antonio dans la NBA, Kim Ng devenir la directrice générale des Marlins de Miami dans la MLB ou les 8 femmes (sur 500) qui ont un poste d’entraîneure dans la NFL sont des exemples positifs pour ces jeunes femmes.
« Ces femmes ont beaucoup d’attention médiatique, ce qui est une bonne chose, souligne Guylaine Demers. Elles montrent que c’est possible. Que les femmes ont leur place dans les sphères décisionnelles. »