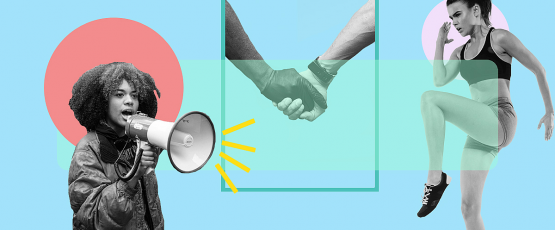Nombre de mouvements et de notions féministes naissent dans les universités, ces lieux d’innovation et de questionnement où se développe l’esprit critique des générations futures. Cet engagement et ces savoirs sont favorisés par des programmes d’études féministes et de genres de plus en plus nombreux, qui accueillent chaque année au Québec de nouvelles cohortes d’étudiant·e·s avides d’apprendre. Malgré les avancées, la mouvance féministe affronte parfois le traditionalisme des grandes institutions.
Les programmes d’études féministes des universités jouent un rôle clé dans les changements sociétaux pour l’égalité des genres. Comme l’explique Alexandra Ketchum, maître de conférences à l’Institut d’études sur le genre, la sexualité et le féminisme de l’Université McGill, cette filière d’études combine la théorie et l’activisme. « Lorsque nous regardons les mouvements féministes ainsi que d’autres mouvements de justice sociale, on y voit à la fois beaucoup de travail sur le terrain fait par les activistes, mais aussi le développement de théories dans un contexte pédagogique. »
Enseigner autrement
Au sein même des universités, les études féministes approchent l’enseignement sous un angle nouveau. « Les auteurs hommes et blancs peuvent se concentrer sur des sujets d’hommes blancs, ce qui constitue une approche très limitée sur de nombreux sujets », explique Alexandra Ketchum. « Une approche analytique d’études féministes permet de diversifier la recherche et l’enseignement au-delà des autres disciplines enseignées. »
Pascale Dufour est professeure titulaire au Département de science politique et responsable du programme de mineure en études féministes des genres et des sexualités à l’Université de Montréal. Elle souligne elle aussi l’influence des études féministes sur les enjeux d’égalité de genres. « L’université n’est pas à côté de la société, elle en fait partie. Ce sont des programmes qui ont une réelle visée de transformation sociale, qui forment des élèves capables de considérer ces aspects dans le monde du travail et dans nos sociétés, quel que soit le métier qu’ils vont exercer par la suite. »
Au Québec, ces études n’ont cependant pas de format standardisé. Certaines universités ont des départements, d’autres des instituts, et d’autres seulement des programmes en études féministes. Cela signifie que le financement n’est pas forcément égal à celui d’autres domaines d’études, ce qui peut pénaliser l’enseignement du féminisme. « Vous pouvez vraiment voir ce qu’une institution valorise par ce qu’elle finance, affirme Alexandra Ketchum. Les départements ont plus de fonds, ils ont plus de professeur·e·s permanents et ils offrent donc plus de stabilité pour les programmes et leurs étudiant·e·s. »
D’autres ne considèrent pas nécessairement ces limitations structurelles comme un frein. Thérèse St-Gelais, professeure au Département d’histoire de l’art et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes à l’Université du Québec à Montréal, voit la richesse des programmes féministes. « C’est sûr que si nous étions un département nous serions plus autonomes. Mais lorsqu’il s’agit de causes à défendre, nos chercheuses et nos chercheurs le font. Nous nous servons de notre site Web et de nos réseaux sociaux pour appuyer et appliquer notre recherche à ce qu’il se passe dans l’actualité ».
Comme l’indique de son côté Pascale Dufour de l’Université de Montréal, où il n’existe qu’une mineure dans le domaine : « On n’a pas un statut d’unité comme un département de sciences politiques ou d’histoire. On a une mise en commun d’un programme interdisciplinaire qui reste aussi important que d’autres disciplines. Car les études féministes, c’est avant tout un ensemble de perspectives théoriques. »
Renverser les tendances
Cependant, les plus grands obstacles systémiques ne se trouvent pas dans le format des programmes en eux-mêmes, mais plutôt dans le fonctionnement universitaire global. Depuis le mouvement #MeToo et ses nombreuses vagues, l’implantation des actions de fond exigées pour mettre fin aux inégalités relationnelles et au harcèlement dans les universités prend du temps.
« Je pense que nous avons eu une sorte de changement performatif, mais je dirais que sur le fond, pas vraiment; ce n’est pas assez », dit Alexandra Ketchum. Les institutions ont tendance à se protéger comme les entreprises, et les universités n’en sont pas exemptées.
« La contestation sociale a changé le visage de l’université, mais ce n’est pas révolutionnaire; on reste face à des institutions lourdes qui ont de la difficulté à bouger, indique Pascale Dufour. Les transformations demandées sont structurelles. Ce sont des rapports de pouvoir qui existent depuis des centaines d’années. Ils font que ce sont essentiellement des hommes blancs qui ont été embauchés pour enseigner dans les années passées. »
« L’université n’est pas à côté de la société, elle en fait partie. Ce sont des programmes qui ont une réelle visée de transformation sociale, qui forment des élèves capables de considérer ces aspects dans le monde du travail et dans nos sociétés, quel que soit le métier qu’ils vont exercer par la suite. »
Ces changements de culture, notamment pour contrer le harcèlement à l’université – qui touche en majorité les femmes –, ont été appuyés au Québec par des initiatives publiques telles que la loi 151. Comme l’explique Jennifer Drummond, coordonnatrice du Centre d’aide aux survivantes et survivants d’agression sexuelle de l’Université Concordia : « Le projet de loi 151 offre un bon équilibre : une institution ne peut pas prendre une éternité pour créer sa politique sur la violence sexuelle en raison des délais fixés par le gouvernement. Et il y a des lignes directrices pour que cette politique soit précise. »
Jennifer Drummond est également responsable du développement d’ateliers universitaires pour contrer le harcèlement. « L’atelier en ligne remplit très bien son rôle pour enseigner un langage commun. L’objectif principal est d’élever le niveau de connaissances des gens sur ce sujet : les sensibiliser davantage et leur faire acquérir les connaissances de base sur le consentement. »
Malgré certaines critiques sur l’insuffisance de telles mesures et la lenteur des changements réclamés, les universités québécoises restent des espaces privilégiés où peut germer la contestation sociale. En effet, avec l’influence notamment de l’afroféminisme étasunien, qui lutte en faveur des minorités racisées ou sexuelles, ces traditions féministes peuvent être discutées dans les universités.
Ce qui n’est pas forcément le cas en France, par exemple. Selon Pascale Dufour, « il y a dans l’espace intellectuel français une décrédibilisation très forte des études de genres et des sciences sociales plus largement ». Cela est dû notamment à des traditions intellectuelles qui reposent sur un universalisme distinct, à la très faible place des femmes en sciences sociales et à l’espace occupé par l’extrême droite dans le paysage politique du pays. En revanche, au Québec, « on est loin de ça », assure Thérèse St-Gelais de l’Université du Québec à Montréal. « On peut faire avancer nos causes un peu plus rapidement, car il y a une oreille ouverte pour ça ici. »
Au-delà des limites structurelles des institutions, les mouvements féministes ont leur place dans les universités québécoises. Avec un corps professoral et un mouvement étudiant investis en grand nombre dans les comités des universités, les valeurs féministes résonnent de plus en plus fort dans les édifices universitaires et se diffusent dans nos sociétés. « Si on n’est pas accueillis, on va s’organiser pour se faire accueillir », conclut Thérèse St‑Gelais, même si la concrétisation de nombreux progrès n’attend toujours que nous…