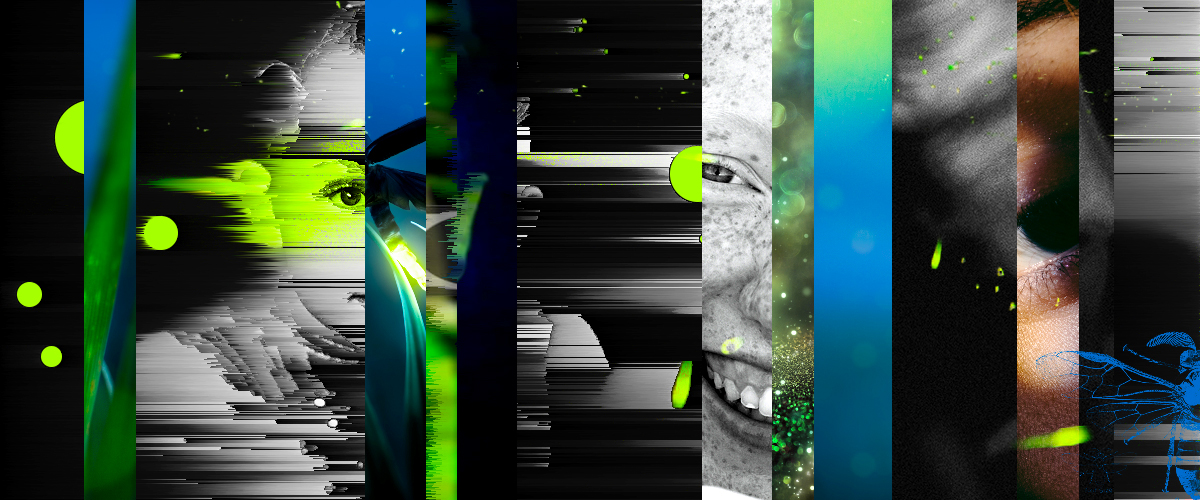Au moment où vous lirez ces lignes, je serai disparue, emportée par une maladie, un accident, ou simplement par le passage des années. Je ne crois pas en une vie après la mort, ni aux âmes qui traînent autour des vivants une fois le cœur arrêté, mais je crois en la persistance des mots. J’aime imaginer qu’ils continuent à vibrer, à résonner, dans l’espace. J’aime penser qu’ils sont inépuisables, impossibles à effacer, et que, petites lumières têtues, ils poursuivent leur course scintillante, poussières d’étoiles.
Encore bien vivante, aujourd’hui, au moment où je vous écris, vivante et féministe jusqu’au bout des choses, je me souviens avoir souvent dit que, malgré tout, malgré les opinions et les prises de position pour défendre les vies des femmes, quelles qu’elles soient, je ne sais pas ce que c’est, « être une femme », je ne sais pas que ça signifie, vraiment.
Comme si c’était un état que je ne sentais pas au plus profond de moi, malgré ma biologie considérée et vécue comme « féminine » – règles (début et fin), grossesses, avortements, enfantement, allaitement –, malgré les jalons qui marquent ma vie « de femme ».
On pourrait croire que j’ai gagné mes épaulettes, que je suis une revenante du champ de bataille qu’est le corps d’une femme, et pourtant, je n’y crois pas, je ne le sens pas, mon identité ne se trouve pas là-dedans, cristallisée. Être une femme ne me dit rien, en vérité. Je comprends que ça veuille tout dire pour certaines, et j’y suis sensible, mais, pour moi, ça ne veut rien dire d’autre que faire partie d’une classe d’individus plus susceptibles que d’autres d’être violentés.
Le mot des autres
Le mot femme ressemble à un mot d’une langue qui ne serait pas la mienne. Ce mot, je le comprends, je peux même le prononcer, l’écrire, mais toujours comme si je le citais; c’est un mot qui ne m’appartient pas complètement. C’est le mot des autres, et je l’ai adopté à moitié, en passant, de manière temporaire ou à des fins stratégiques, pour qu’on se comprenne, pour qu’on puisse continuer à avancer.
Ce mot, femme, évoque, pour moi, un costume, un carcan, une prison, un code de lois, une technologie, un récit, un film dans lequel je joue un rôle, parfois avec sérieux, d’autres fois avec joie, et d’autres fois encore avec ironie, colère ou tristesse, mais jamais en y croyant entièrement. Comme si le fait d’exister, même dans cette peau-là qui a tout d’une peau « de femme », avait à voir avec autre chose que ça. Comme si je persistais à croire qu’il ne doit pas y avoir de chaîne, ni de cadenas, entre la personne qu’on est et le corps dans lequel le hasard nous a fait tomber.
Comme l’a souligné Paul B. Preciado en janvier 2020, depuis l’hiver pendant lequel je vous écris, l’identité « femme » n’existe pas, mais elle peut vous coûter la vie. Il en est de même pour l’identité « trans » ou raciale. Des identités que Preciado fait le pari de décrire, à la suite de Michel Foucault, comme, en vérité, « inexistantes ». Des identités qui ne font pas le poids, même si un ensemble de processus nous enjoignent d’y croire en régulant de mille et une façons notre vie et notre mort. Les identités n’existent pas sinon comme un ensemble de contraintes qui visent à nous enfermer dans le corps.
C’est le cas des personnes qui sont marquées de l’identité « femme », et dont je fais partie, moi-même femme tout en vivant comme si ce n’était pas tout à fait le cas. En me disant qu’il ne s’agit toujours bien que d’un corps dont le fonctionnement est imparfait et un peu arbitraire, refusant d’être réduite à ce qui se cache à l’intérieur de ma coquille de chair tout autant qu’à la manière dont celle-ci se présente au regard extérieur.
L’aube d’un monde
Au moment où je dépose ces mots sur l’écran d’un avenir où je ne serai plus, je suis encore vivante, fatiguée mais vivante, mue par l’envie d’imaginer ce qui viendra. J’ai envie de vous imaginer, vous. Vous qui aurez été le tissu de mes rêves ma vie durant, l’élan de mon imaginaire, la raison pour laquelle j’ai travaillé avec d’autres à repenser le monde.
Je veux penser que vous incarnez cet horizon imaginaire qui aura guidé mon travail, un horizon fait d’organismes libérés du domicile fixe qu’est l’identité.
Aujourd’hui, je veux penser que vous incarnez cet horizon imaginaire qui aura guidé mon travail, un horizon fait d’organismes libérés du domicile fixe qu’est l’identité. Un monde d’individus déchargés de la mise en demeure qui opère dès avant la naissance et qui les oblige à répondre d’un genre.
Aujourd’hui, je veux vous imaginer clignotant dans la nuit de l’avenir, lucioles et survivances. Je veux penser que vous êtes au début d’un monde où le sexe et le genre ne compteront pas, ne compteront plus comme avant. Un monde où ce qui vit n’aura plus besoin de s’inscrire ou d’être inscrit dans une catégorie aux bords clairement délimités. Un monde où ce qui comptera, justement, c’est la vie.
Je ne sais pas si, au moment de ma mort, tout aura été gagné, si les luttes se seront épuisées faute d’objets, ou si l’on se trouvera toujours devant l’éternel recommencement. Je ne sais pas ce qu’il restera de ce qu’au fil du temps on a appelé la « lutte des sexes » – quels vestiges, quelles traces, quelle mémoire des gestes militants et des bibliothèques, des révolutions du corps et de la pensée? Quelles révolutions de mots tournés dans tous les sens pour arriver au bout de l’enfermement, de l’emprise, de l’asphyxie?
Je ne sais pas si le mot féminisme lui-même fera encore partie de votre vocabulaire. J’espère que non… J’espère qu’il aura pâli jusqu’à être effacé, lavé par le passage des années. J’espère qu’il appartiendra à cette époque ancienne où il fallait défendre l’existence de la moitié de l’humanité, menacée de mort à cause de son genre. Une époque dépassée qui vous paraîtra incroyable de bêtise et de méchanceté.
En attendant, je nous souhaite patience, détermination, résilience, courage. On se retrouvera de l’autre côté du temps!
Romancière, essayiste et militante féministe, Martine Delvaux est professeure de littérature des femmes à l’Université du Québec à Montréal. Parmi ses publications : Le boys club (Remue-ménage, 2019), Les filles en série : Des Barbies aux Pussy Riot (Remue-ménage, 2013 [édition revue et augmentée, 2018]), Thelma, Louise & moi (Héliotrope, 2018) et Blanc dehors (Héliotrope, 2015).