En juin dernier, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a remis son rapport sur les pensionnats catholiques autochtones où, de 1820 aux années 1990, on a envoyé 150 000 enfants arrachés à leur famille pour leur faire « oublier » leur culture. Nombre d’entre eux y ont, on le sait aujourd’hui, subi des mauvais traitements et des agressions sexuelles. Un « génocide culturel », a conclu la Commission. Dans son rapport, elle émet de nombreuses recommandations pour enrayer les différents maux qui accablent, aujourd’hui encore, les populations autochtones au pays : pauvreté, alcoolisme, toxicomanie, violence, maladies, grossesses précoces, etc. Il en est un autre, moins connu, qui touche essentiellement les femmes : la prostitution forcée. La Gazette des femmes s’est entretenue avec la journaliste Emmanuelle Walter, auteure du livre Sœurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada (Lux Éditeur, 2014), pour essayer de mesurer l’ampleur du phénomène.
Gazette des femmes : Avant d’écrire votre livre, saviez-vous qu’il existait une traite des femmes autochtones au Canada?
Emmanuelle Walter : Non, et c’est sans doute ce qui m’a le plus troublée : quand j’ai compris que le Canada (et le Québec en fait partie) était le théâtre d’un trafic de femmes autochtones.
Peut-on vraiment parler de traite?
Les femmes autochtones sont surreprésentées parmi les prostituées. À Winnipeg, de 70 à 80 % de la prostitution de rue est le fait de femmes autochtones, alors qu’on sait qu’elles ne représentent que 4 % de la population féminine au Canada… On sait que 14 à 60 % des jeunes autochtones s’adonnent à la prostitution dans diverses régions du pays. On peut parler de traite dans la mesure où c’est une prostitution organisée et forcée. Mais comme cela prend le plus souvent les allures de la prostitution de rue, le trafic demeure invisible, car depuis les débuts de la colonisation, il y a des femmes autochtones qui se prostituent. Parmi le millier de femmes disparues et assassinées dont je fais état dans mon livre, beaucoup sont des prostituées, bien que ces agressions touchent aussi des autochtones qui ne se prostituent pas. Des chercheuses autochtones ont d’ailleurs mené quelques études qui font état de ce trafic, mais personne n’en parle.
Dans les faits, comment s’organise ce trafic?
L’Association des femmes autochtones du Canada a remis un rapport de 75 pages sur le sujet l’an dernier. On y détaille plusieurs méthodes de recrutement, qui vont de la coercition à la violence en passant par la promesse d’une vie meilleure. Parfois, c’est un membre de la famille ou même un petit ami qui va initier la jeune fille au commerce du sexe. Parfois, elles vont se faire embarquer par des gangs de rues ou vont entrer dans des services d’escortes. Dans certains cas, ces filles sont toxicomanes; quelquefois, des proxénètes, autochtones ou blancs, les rendent volontairement « accros » pour les forcer à se prostituer. Le rapport a montré que le recrutement se fait dans des lieux aussi variés que les aéroports, les écoles, les bars, les bars de danseuses, les autoroutes où certaines font de l’autostop, etc.

« Les militantes féministes autochtones font souvent le lien entre l’attaque faite aux terres et l’attaque faite aux femmes. … On extrait du pétrole ou du minerai et on exploite les femmes. »
Il y a aussi des filles des réserves du Nord, mais aussi des Inuites du Grand Nord qui débarquent à Montréal. Elles sont attendues à la gare d’autocars par des pimps qui sont informés de leur venue. Ces filles-là fuient souvent la violence de leur propre milieu… Elles arrivent en ville et elles sont exploitées. Dans son film Le commerce du sexe, la documentariste Ève Lamont évoque ce phénomène et montre que Montréal, comme d’autres grandes villes canadiennes, est une plaque tournante du trafic du sexe autochtone. C’est moins visible que dans l’Ouest, mais cela existe.
Ce commerce du sexe autochtone aurait un lien avec les grands chantiers miniers ou pétroliers. Quel est-il?
Certaines études font même état d’une traite triangulaire entre Saskatoon, Edmonton et Calgary, qui suit les déplacements des hommes qui vont travailler dans des mines ou des installations pétrolières. Je ne pourrais le confirmer, mais ce n’est certainement pas la première fois qu’un lien direct est établi entre l’« extractivisme », c’est-à-dire l’exploitation des ressources naturelles, et l’exploitation sexuelle des femmes. Ça remonte aux débuts de la colonisation : les coureurs des bois épousaient parfois des femmes autochtones de manière égalitaire, mais il y avait aussi de la prostitution. Les colons arrivaient, il n’y avait pas de femmes, la prostitution s’installait. Parfois, les chefs autochtones eux-mêmes offraient leurs femmes aux postes de traite. Aujourd’hui, la prostitution est encore très répandue à Fermont, Schefferville ou Fort McMurray, des villes situées près de réserves amérindiennes et qui comptent des chantiers miniers ou pétroliers. Les filles ont besoin d’argent et il y a des centaines d’hommes sans femmes qui débarquent. La prostitution se répand.
Une équipe d’Amnistie internationale a passé 15 jours à Fort St. John, en Colombie-Britannique, près de la fameuse « autoroute des larmes », où des dizaines de femmes autochtones ont disparu. Une des hypothèses pour expliquer ces disparitions est la présence d’hommes blancs qui débarquent pendant l’hiver pour l’exploitation pétrolière. Les militantes féministes autochtones font souvent le lien entre l’attaque faite aux terres et l’attaque faite aux femmes. Or, il se trouve qu’effectivement, ces deux formes d’exploitation sont concomitantes. On extrait du pétrole ou du minerai et on exploite les femmes.
La bougie d’allumage
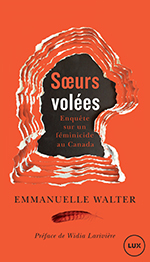
Quand Emmanuelle Walter a appris que l’ONU souhaitait réaliser une enquête sur la disparition massive de femmes autochtones au Canada, elle n’a plus été en paix. Elles sont 1 186 à avoir disparu au pays entre 1980 et 2012, sans que personne ou presque ne s’en alarme. Obsédée par ce « film d’horreur dans un pays de cocagne »
, la journaliste s’est lancée dans une vaste enquête où chaque nouvelle découverte la plongeait plus avant dans l’incompréhension et le drame. Son point de départ : la disparition, en septembre 2008, de Maisy Odjick, 16 ans, de Kitigan Zibi, une réserve algonquine au nord d’Ottawa, et de son amie, Shannon Alexander, 17 ans, de Maniwaki. Son livre Sœurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada (qui vient récemment d’être traduit en anglais aux éditions HarperCollins Canada) rend compte de cette quête.
Emmanuelle Walter, Sœurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada, Lux éditeur, 2014, 224 p.


